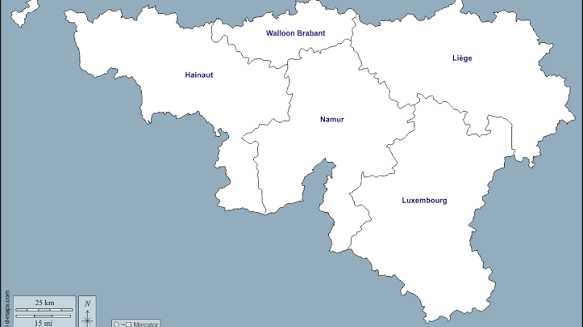Cet été, comme souvent en Belgique, l’actualité politique s’est heurté à la mécanique complexe d’un gouvernement de coalition.
À lire les réactions en cascade à propos de l’accord d’été, entre CPAS, F-35, pension et soins de santé, on perçoit un malaise profond : celui d’un pays où les compromis ne construisent plus une vision commune, mais juxtaposent des visions différentes.
La Belgique est un pays de compromis. Son système électoral proportionnel rend quasiment impossible l’existence de majorités unicolores. C’est une réalité démocratique assumée : les partis doivent s’entendre. Cela suppose l’art difficile du dialogue, de la négociation et surtout, de la concession. Chaque parti doit abandonner certaines revendications pour que l’ensemble avance. Mais cette dynamique, autrefois gage de stabilité, semble s’être déréglée.
Autrefois les partis construisaient la démocratie de notre pays. Aujourd’hui, les parti sont devenus la démocratie de notre pays. Voilà pourquoi l’on parle de « particratie ».
Et c’est un problème fondamental. D’autant plus grand qu’il repose sur l’idée que la démocratie interne des partis devrait fonctionner de manière lisible et respectueuse des élus qui le composent.
Aujourd’hui, les coalitions donnent parfois l’impression de fonctionner sur un principe bancal : celui de l’addition de divergences, plutôt que de la synthèse des visions. Comme si, au lieu de chercher un cap commun, on collait bout à bout des mesures incompatibles, en veillant à ce que chaque parti ait « son » trophée, tout en essayant que les autres ne gagnent pas trop.
Le résultat ? Des politiques publiques qui manquent de cohérence, parfois contradictoires, souvent illisibles pour les citoyens et qui manquent forcément toujours d’ambition.
C’est comme si l’on essayait de faire une tarte en mélangeant des pommes, du ciment et de la mayonnaise : chacun y reconnaît un ingrédient, mais personne n’a envie d’en manger.
Cette incohérence systémique alimente le désenchantement politique. Elle crée une fracture croissante entre les citoyens et leurs représentants, une impression que la politique n’est plus guidée par l’intérêt général, mais par des calculs particratiques.
Pourtant, la démocratie belge devrait retrouver de la vigueur. Cela implique une redéfinition du rôle des gouvernants : il ne s’agit plus seulement de défendre une étiquette partisane, mais d’incarner un esprit d’État. Être élu ne devrait pas signifier uniquement porter les intérêts de son propre parti politique, mais aussi s’efforcer de construire des compromis durables et cohérents au service du pays.
La Belgique gagnerait à ce que ceux qui gouvernent placent l’intérêt collectif au-dessus de leur agenda électoral.
Que les partis osent une véritable culture de la co-construction, non pas dans l’urgence ou la stratégie, mais dans l’ambition et la cohérence.
Et dans la conviction que la vérité se retrouve partout, même chez son adversaire politique.
Alors, bien sûre que cet été a marqué des avancées et des améliorations pour notre pays. Avec une attention majeure portée à la préservation de notre modèle social tout en garantissant notre sécurité.
Mon propos n’est pas de dénoncer un mauvais accord.
Mon propos est juste de dire que nous sommes en capacité d’être meilleur. Et, dans ce monde qui file à toute vitesse, être meilleur, c’est quand même beaucoup mieux, non…?
C’est de tout cœur ce que je souhaite à la future génération politique : réconcilier responsabilité et vision, et redonner ses lettres de noblesse à l’engagement public.